
Installer des caméras au Québec ne consiste pas à choisir le meilleur matériel, mais à pouvoir justifier chaque pixel capturé face à la loi.
- La Commission d’accès à l’information (CAI) évalue la légitimité de votre système non pas sur sa performance, mais sur sa proportionnalité entre le risque sécuritaire réel et l’atteinte à la vie privée.
- Les technologies avancées comme l’IA et la reconnaissance faciale ne sont pas des améliorations automatiques ; elles augmentent de façon exponentielle vos obligations légales et les risques de sanctions.
Recommandation : Pensez comme la Commission d’accès à l’information avant votre installateur : documentez le « pourquoi » avant de décider du « comment ».
En tant que responsable de la sécurité ou chef d’entreprise au Québec, l’idée d’installer un système de caméras de surveillance semble être une évidence pour protéger vos biens, vos employés et vos clients. Le réflexe est souvent de rechercher la technologie la plus performante, la caméra offrant la meilleure résolution, ou la solution de stockage la plus vaste. On pense à l’emplacement, à l’angle de vue, à la vision nocturne. Pourtant, cette approche purement technique omet la question la plus cruciale dans le contexte québécois actuel : ce que vous vous apprêtez à capturer est-il légal ?
Avec l’entrée en vigueur de la Loi 25, le paradigme a changé. La discussion ne porte plus uniquement sur la sécurité, mais sur l’équilibre délicat avec la protection des renseignements personnels. La Commission d’accès à l’information (CAI) est claire : la vidéoprotection est une mesure intrusive qui doit rester l’exception, et non la norme. Chaque caméra installée est une collecte de données personnelles, et chaque enregistrement une base de données sensible qu’il vous incombe de protéger.
Mais si la véritable clé n’était pas de naviguer dans un labyrinthe de restrictions, mais plutôt d’adopter une démarche de justification proactive ? Cet article propose un changement de perspective. Au lieu de vous demander ce que la loi vous interdit de faire, nous allons explorer comment construire un projet de vidéoprotection qui soit intrinsèquement défendable. Il ne s’agit pas de voir le moins possible, mais de voir juste : collecter uniquement les informations nécessaires pour répondre à un risque démontré, de la manière la moins intrusive qui soit.
Nous allons déconstruire le processus de décision, du choix de l’emplacement à l’intégration de l’intelligence artificielle, en passant par la sélection de la technologie. L’objectif est de vous armer non seulement d’un système de sécurité efficace, mais aussi d’un dossier de conformité solide, prêt à répondre aux exigences les plus strictes. Car au Québec, la meilleure défense de votre système de surveillance est la qualité de sa conception éthique et légale.
Cet article vous guidera à travers les étapes essentielles pour concevoir et exploiter un système de vidéoprotection (CCTV) à la fois performant, éthique et rigoureusement conforme aux lois québécoises. Explorez avec nous les nuances qui transforment une simple installation de caméras en un véritable atout stratégique pour votre sécurité.
Sommaire : Concevoir un système de vidéoprotection conforme à la Loi 25 au Québec
- Où avez-vous le droit d’installer des caméras (et où est-ce totalement interdit) ?
- Avant de choisir une caméra, posez-vous la bonne question : que voulez-vous vraiment voir ?
- Caméra IP, thermique, analogique : le guide pour choisir la technologie adaptée à votre besoin
- Vos enregistrements vidéo sont des données sensibles : l’erreur de les stocker sans protection
- L’IA dans vos caméras : comment les rendre intelligentes pour qu’elles ne vous alertent que lorsque c’est nécessaire ?
- Le cadre légal de la biométrie au Québec : ce que vous devez absolument savoir avant de vous lancer
- Le futur du contrôle d’accès : l’intégration totale avec votre système de sécurité global
- Votre système d’alarme est-il un gadget bruyant ou un véritable dispositif de sécurité ?
Où avez-vous le droit d’installer des caméras (et où est-ce totalement interdit) ?
La première question à se poser ne concerne pas la technologie, mais la géographie de la surveillance. Au Québec, le droit d’installer une caméra dépend fondamentalement de ce que la jurisprudence appelle « l’attente raisonnable en matière de vie privée ». Plus cette attente est élevée, plus le droit à la surveillance diminue. Il est donc formellement interdit de placer des caméras dans des lieux comme les toilettes, les vestiaires ou les salles de soins, où l’intimité est absolue. La surveillance audio est également considérée comme extrêmement intrusive et est, dans la quasi-totalité des cas, illégale dans un contexte de surveillance générale.
À l’inverse, dans les zones publiques à haut risque comme les guichets automatiques ou les dépanneurs, la jurisprudence reconnaît une attente de vie privée plus faible, rendant la vidéosurveillance plus facilement justifiable pour des raisons de sécurité. Cependant, même dans les zones autorisées, la surveillance doit être ciblée. Par exemple, filmer constamment les postes de travail des employés est interdit, car cela s’apparente à une surveillance de la productivité, une fin jugée illégitime. La caméra doit cibler un risque précis (ex: une caisse, une entrée) et non les personnes.
Étude de Cas : La décision Crane Supply et la surveillance minimisée
Dans une décision marquante de septembre 2025, la Commission d’accès à l’information s’est penchée sur l’usage de caméras dans les cabines de camions de livraison. Bien que les objectifs de sécurité de l’entreprise fussent reconnus comme légitimes, la CAI a jugé que la surveillance continue portait une atteinte disproportionnée à la vie privée des chauffeurs. Suite à la décision de la Commission, l’entreprise a dû modifier son système pour limiter la collecte d’images à quelques secondes avant et après un événement de conduite dangereux (un freinage brusque, par exemple) et cesser toute collecte lorsque le moteur est à l’arrêt. Cet exemple illustre parfaitement le principe de minimisation : on ne collecte que ce qui est strictement nécessaire pour atteindre l’objectif de sécurité.
Pour vous aider à y voir plus clair, voici une synthèse des zones où la surveillance est généralement permise ou interdite, basée sur les lignes directrices du Commissariat à la protection de la vie privée et la jurisprudence québécoise.
| Zone | Surveillance permise | Justification légale |
|---|---|---|
| Guichets automatiques | ✓ Oui | Attente raisonnable de surveillance pour la sécurité dans les zones à risque |
| Dépanneurs (zones à risque) | ✓ Oui | Zones où le taux de criminalité est élevé justifient la surveillance |
| Garage d’immeuble | ✓ Oui (limitée) | Sécurité autorisée mais interdiction de suivre les déplacements des locataires |
| Toilettes publiques | ✗ Non | Les personnes s’attendent au respect de leur vie privée |
| Salles de traitement/spas | ✗ Non | La surveillance vidéo est inappropriée dans ces espaces intimes |
En somme, l’emplacement n’est pas un choix anodin. Il doit être le résultat d’une analyse de risque documentée qui démontre qu’aucune autre mesure moins intrusive ne pourrait atteindre le même niveau de sécurité. Chaque caméra doit avoir sa raison d’être, spécifiquement liée à la zone qu’elle surveille.
Avant de choisir une caméra, posez-vous la bonne question : que voulez-vous vraiment voir ?
Le piège classique est de penser en termes de matériel : « J’ai besoin d’une caméra 4K avec vision nocturne ». L’approche conforme à la Loi 25 est radicalement différente. Elle commence par la question : « Quel problème de sécurité réel, important et documenté cherchè-je à résoudre ? » La réponse à cette question dictera non seulement la nécessité de la surveillance, mais aussi la nature de la technologie à déployer. Si votre objectif est de prévenir les vols à l’étalage, la nécessité de capturer un visage identifiable est plus forte que si vous cherchez simplement à surveiller un périmètre la nuit pour détecter une intrusion.
La CAI s’attend à ce que vous ayez mené cette réflexion en amont. Comme le précise la jurisprudence, une entreprise doit démontrer le caractère légitime, réel et important de ses objectifs. L’entreprise Crane Supply invoquait par exemple la sécurité des conducteurs et la prévention des infractions. Ces fins étaient légitimes, mais la méthode (surveillance continue) a été jugée disproportionnée. Votre justification doit donc être un équilibre entre l’objectif visé et l’atteinte à la vie privée.
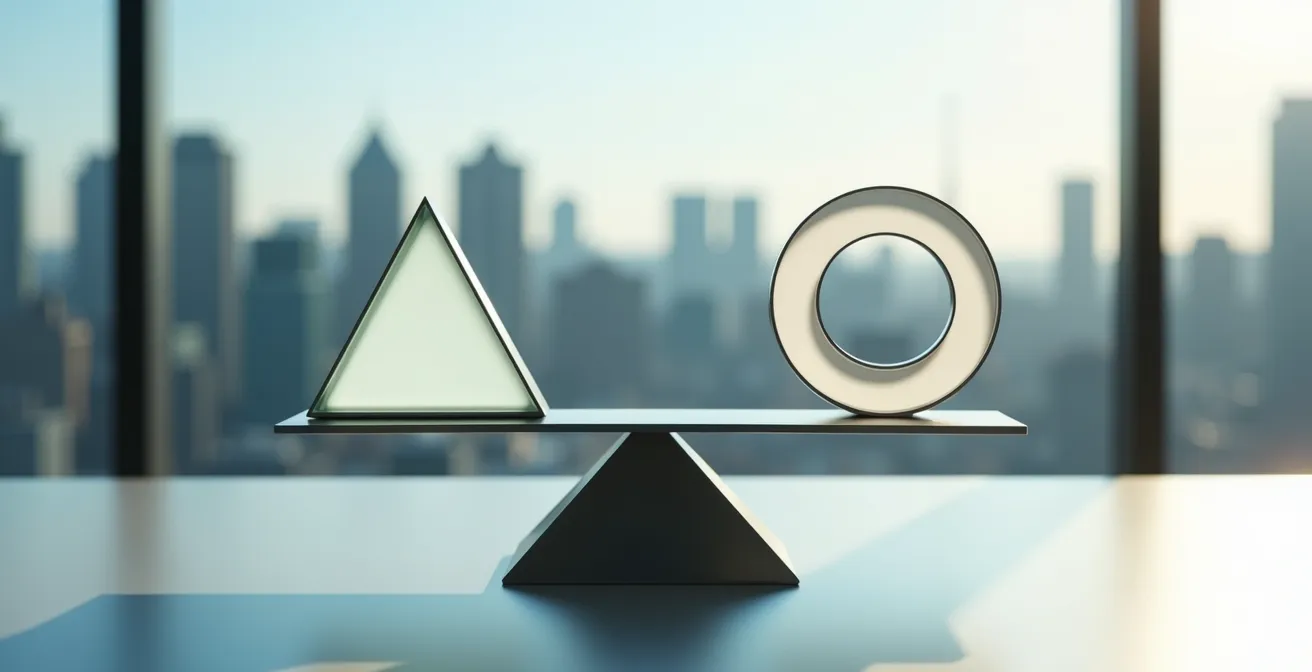
Ce processus de justification est le cœur de votre dossier de conformité. Vous devez être capable de prouver que la vidéosurveillance n’est pas une solution de facilité, mais une mesure nécessaire après avoir évalué d’autres alternatives moins intrusives (meilleur éclairage, serrures renforcées, agents de sécurité, etc.). La documentation de cette analyse est essentielle. Pourquoi ces alternatives sont-elles insuffisantes ? C’est ce que la CAI examinera en cas de plainte. Le choix de « voir » doit toujours être le dernier recours, et non le premier réflexe.
Cette réflexion doit aussi inclure la minimisation de la collecte. Avez-vous besoin d’enregistrer 24/7, ou un enregistrement déclenché par un événement (ex: ouverture de porte en dehors des heures de bureau) serait-il suffisant ? Avez-vous besoin d’une image couleur haute définition, ou une image thermique qui détecte une présence sans identifier la personne pourrait-elle faire l’affaire ? Se poser ces questions, c’est déjà penser comme un régulateur et construire un système robuste sur le plan légal.
Finalement, l’enjeu est de passer d’une logique de « capturer le plus de détails possible » à une logique de « capturer juste assez d’informations pour répondre à un besoin précis ». C’est ce changement de mentalité qui vous protégera non seulement des menaces physiques, mais aussi des risques légaux et financiers considérables.
Caméra IP, thermique, analogique : le guide pour choisir la technologie adaptée à votre besoin
Une fois votre objectif de sécurité clairement défini et justifié, le choix de la technologie devient une décision stratégique. Chaque type de caméra présente des avantages, mais aussi des risques spécifiques au regard de la Loi 25. La « meilleure » caméra n’est pas la plus performante, mais celle qui répond à votre besoin de la manière la moins intrusive possible. Par exemple, une caméra thermique peut être idéale pour la détection périmétrique nocturne, car elle détecte la présence humaine sans collecter de données biométriques identifiantes comme les traits du visage.
Les caméras IP connectées au cloud offrent une grande flexibilité d’accès, mais soulèvent immédiatement la question de la souveraineté des données. Si vos enregistrements sont stockés sur des serveurs situés hors du Québec, la Loi 25 vous impose de réaliser une Évaluation des Facteurs relatifs à la Vie Privée (ÉFVP) pour vous assurer que le niveau de protection est équivalent à celui du Québec. Cette démarche administrative n’est pas à prendre à la légère. À l’inverse, un système analogique traditionnel conserve les données localement, éliminant ce risque, mais peut compliquer l’exercice du droit à la portabilité des données par une personne filmée.
La vigilance est particulièrement de mise avec les technologies intégrant l’intelligence artificielle. Une caméra capable de reconnaissance faciale transforme une simple image en une donnée biométrique. Comme l’a montré la décision de la CAI interdisant à Metro Inc. de déployer un tel système pour la prévention des pertes, l’utilisation de la biométrie est extrêmement réglementée et nécessite un consentement explicite, quasi impossible à obtenir dans un lieu public ou une relation employeur-employé.
Plan d’action : Les questions clés à poser à votre installateur
- Hébergement des données : Comment votre solution assure-t-elle que tous les enregistrements et métadonnées sont hébergés au Canada, idéalement au Québec, conformément à la Loi 25 ?
- Gestion des accès : Votre plateforme permet-elle de créer des profils d’utilisateurs distincts avec des droits différents (ex: un agent de sécurité peut voir le direct, mais seul un responsable RH peut exporter une séquence) ?
- Traçabilité : Le système journalise-t-il chaque accès aux enregistrements (qui, quand, quoi) ? Cette traçabilité est-elle facilement exportable pour un audit de la CAI ?
- Minimisation par la technique : Votre système permet-il de configurer des masques de confidentialité pour flouter certaines zones (ex: un bureau voisin, un clavier de NIP) et de ne pas les enregistrer ?
- Conformité à la portabilité : En cas de demande d’accès d’une personne filmée, le système permet-il d’extraire facilement la séquence vidéo la concernant dans un format structuré et couramment utilisé ?
En conclusion, dialoguer avec votre installateur ne doit plus se limiter à des questions de câblage et de résolution. Le dialogue doit désormais intégrer en profondeur les enjeux de conformité à la Loi 25. Un bon intégrateur en 2024 n’est pas seulement un technicien, c’est un partenaire dans votre stratégie de gestion du risque informationnel.
Vos enregistrements vidéo sont des données sensibles : l’erreur de les stocker sans protection
Capturer une image est la première étape. La seconde, tout aussi cruciale, est de la protéger. Chaque seconde d’enregistrement vidéo constitue un renseignement personnel sensible. Le stocker sur un enregistreur (NVR/DVR) non sécurisé dans un placard non verrouillé est une violation directe de vos obligations en vertu de la Loi 25. Vous êtes légalement responsable de la confidentialité, de l’intégrité et de la disponibilité de ces données. Un vol ou un accès non autorisé à ces enregistrements peut constituer un incident de confidentialité que vous êtes tenu de déclarer à la CAI et aux personnes concernées.
La protection de ces données est à la fois physique et logique. Physiquement, l’équipement de stockage doit se trouver dans un local sécurisé, à accès contrôlé (salle de serveurs, armoire verrouillée). Logiquement, l’accès au système doit être protégé par des mots de passe robustes et, idéalement, une authentification multifacteur. Il est préoccupant de noter que seulement 39% des entreprises québécoises utilisent l’authentification multifacteur, un chiffre bien inférieur à la moyenne canadienne, ce qui indique une marge de progression importante.

La durée de conservation est un autre pilier de la conformité. Vous ne pouvez pas conserver les enregistrements indéfiniment. Vous devez établir une politique de rétention justifiée par votre objectif. Pour un commerce de détail, une durée de 7 à 14 jours est souvent considérée comme raisonnable. Pour des besoins d’enquête suite à un incident, une conservation de 30 à 45 jours peut se justifier, mais doit être documentée. Passé ce délai, les données doivent être détruites de manière sécurisée. Les statistiques sont claires : bien que les incidents diminuent, le risque demeure. Selon Statistique Canada, 16% des entreprises canadiennes ont été touchées par des incidents de cybersécurité en 2023. Ne pas protéger adéquatement vos enregistrements vidéo, c’est laisser une porte ouverte aux cybercriminels.
Enfin, la Loi 25 exige la nomination d’un Responsable de la protection des renseignements personnels (souvent le PDG par défaut, mais la fonction peut être déléguée). Son titre et ses coordonnées doivent être publiés sur le site web de votre entreprise. Cette personne est le point de contact pour toute demande d’accès aux enregistrements par une personne filmée et est garante de la politique de gouvernance des données.
Traiter vos enregistrements vidéo avec le même niveau de rigueur que vos données financières ou client n’est plus une bonne pratique, c’est une obligation légale. La négligence en la matière expose votre entreprise à des risques bien plus grands que le vol d’un simple enregistreur.
L’IA dans vos caméras : comment les rendre intelligentes pour qu’elles ne vous alertent que lorsque c’est nécessaire ?
L’intelligence artificielle (IA) transforme la vidéosurveillance passive en un outil de sécurité proactif. Plutôt que de visionner des heures d’enregistrements après un incident, l’IA peut analyser le flux vidéo en temps réel et vous alerter uniquement lorsqu’un événement pertinent se produit. C’est le passage d’une surveillance continue et intrusive à une surveillance « focalisée sur l’événement », une approche beaucoup plus alignée avec le principe de minimisation de la collecte prôné par la Loi 25.
L’IA prend tellement de place que la SIA l’a divisée en quatre volets : la sécurité de l’IA; l’IA et l’intelligence visuelle; l’IA générative; et la réglementation de l’IA
– Security Industry Association, Rapport des grandes tendances de la sécurité 2024
Les applications de l’IA qui respectent la vie privée sont nombreuses. La détection de franchissement de ligne peut vous alerter si quelqu’un pénètre dans une zone restreinte après les heures d’ouverture. Le comptage de personnes peut vous fournir des données statistiques anonymisées sur la fréquentation sans identifier personne. La détection d’objet abandonné peut signaler un colis suspect. Dans tous ces cas, l’IA agit comme un filtre intelligent, ne remontant que l’information utile et réduisant massivement la quantité de données personnelles à traiter par un humain.
Cependant, toutes les fonctions d’IA ne sont pas égales face à la loi. Le risque augmente drastiquement dès que l’IA se met à analyser les caractéristiques des personnes. L’analyse comportementale (détection de « comportement suspect ») ou, pire encore, la reconnaissance faciale, sont des terrains minés sur le plan légal. La reconnaissance faciale est une collecte de données biométriques soumise à un régime de consentement explicite et peut entraîner des amendes allant jusqu’à 25 millions de dollars ou 4% du chiffre d’affaires mondial en cas d’infraction.
Le choix d’activer une fonction d’IA doit donc faire l’objet d’une analyse de proportionnalité rigoureuse. L’efficacité accrue justifie-t-elle l’atteinte supplémentaire à la vie privée ? Une ÉFVP est souvent obligatoire pour ces technologies avancées.
| Fonction IA | Statut légal | Justification | Obligations |
|---|---|---|---|
| Détection de mouvement | ✓ Légal | Pas de collecte biométrique | Information simple |
| Comptage de personnes | ✓ Légal | Données anonymisées | Politique de conservation |
| Reconnaissance faciale | ✗ Très restreint | Collecte biométrique soumise à consentement explicite, amendes jusqu’à 25M ou 4% du CA | Consentement explicite impossible en contexte employeur-employé |
| Analyse comportementale | ⚠ À risque | Pousse vers un marketing plus humain et responsable selon la Loi 25 | ÉFVP obligatoire |
En définitive, l’IA peut être votre meilleure alliée pour la conformité, à condition de la cantonner à un rôle de détection d’événements objectifs et anonymes. Dès qu’elle commence à interpréter ou à identifier des individus, elle devient votre plus grand risque légal.
Le cadre légal de la biométrie au Québec : ce que vous devez absolument savoir avant de vous lancer
Si la vidéoprotection est un domaine sensible, l’utilisation de la biométrie est un véritable champ de mines légal au Québec. La biométrie consiste à utiliser des caractéristiques physiques ou comportementales uniques (empreintes digitales, iris, traits du visage) pour vérifier ou confirmer l’identité d’une personne. Dès qu’un système de surveillance va au-delà de la simple capture d’image pour analyser et extraire ces données, il tombe sous le coup d’un cadre réglementaire extrêmement strict.
La règle d’or est simple : toute collecte de renseignements biométriques nécessite le consentement explicite, manifeste, libre, éclairé et donné à des fins spécifiques de la personne concernée. Dans le contexte de la surveillance d’espaces publics ou de lieux de travail, obtenir un tel consentement est pratiquement impossible. Un employé ne peut donner un consentement « libre » à son employeur, en raison du déséquilibre de pouvoir inhérent à la relation. La jurisprudence de la CAI est constante et sévère sur ce point.
L’extraction de données biométriques à partir d’images de surveillance brutes doit se conformer aux obligations strictes de la Loi québécoise sur les technologies de l’information
– Commission d’accès à l’information du Québec, Décision Metro Inc. – Interdiction de reconnaissance faciale
Avant même d’envisager une technologie biométrique (comme un contrôle d’accès par empreinte digitale ou une caméra à reconnaissance faciale), vous devez prouver qu’il n’existe aucune autre solution moins intrusive pour atteindre votre objectif de sécurité. Cette démonstration est très difficile à faire. Il existe en effet de nombreuses alternatives efficaces qui n’impliquent pas la collecte de données aussi sensibles.
Opter pour la biométrie n’est donc pas une décision technique, mais une décision stratégique à très haut risque qui doit être validée au plus haut niveau de l’entreprise et appuyée par un avis juridique solide. Dans 99% des cas pour une PME, la réponse est simple : évitez. Les risques financiers et réputationnels en cas de non-conformité sont tout simplement trop élevés.
Plan d’action : Alternatives légales au contrôle d’accès biométrique
- Cartes d’accès avec NIP : Une authentification à deux facteurs classique (quelque chose que vous avez et quelque chose que vous savez) qui est robuste et non intrusive.
- Authentification via téléphone professionnel : Utiliser une application sur le téléphone fourni par l’entreprise pour valider l’accès, une autre forme d’authentification multifacteur.
- Badges RFID : Des cartes ou porte-clés de proximité qui permettent un accès rapide tout en journalisant les passages sans collecter de données biométriques.
- Codes d’accès temporaires : Pour les visiteurs ou les accès ponctuels, des codes uniques à durée de vie limitée sont une solution simple et sécurisée.
- Systèmes conformes au consentement : Dans les très rares cas où la biométrie est justifiable, le système doit respecter scrupuleusement le processus de consentement exigé par la CAI.
En somme, le message de la CAI est clair : la commodité offerte par la biométrie ne justifie presque jamais l’atteinte considérable qu’elle porte à la vie privée. La prudence et le recours à des technologies éprouvées et moins intrusives restent la voie la plus sûre.
Le futur du contrôle d’accès : l’intégration totale avec votre système de sécurité global
Un système de sécurité moderne ne fonctionne plus en silos. La véritable efficacité naît de l’intégration et de la corrélation d’événements entre vos différents dispositifs : contrôle d’accès, alarme d’intrusion et vidéoprotection. Cette approche intégrée permet non seulement de renforcer la sécurité, mais aussi d’aider à la conformité avec la Loi 25 en justifiant la collecte de données par des événements précis.
Imaginons un scénario : une tentative d’accès à une porte sensible est refusée en dehors des heures de bureau. Un système non intégré ne ferait que journaliser l’événement. Un système intégré, lui, peut déclencher une série d’actions automatisées : la caméra la plus proche pivote vers la porte, enregistre une séquence de 30 secondes (15 avant, 15 après), et une alerte est envoyée au responsable de la sécurité avec la séquence vidéo jointe. Ici, l’enregistrement vidéo n’est pas continu ; il est déclenché par un événement de sécurité légitime. Cette « corrélation d’événements » fournit une justification parfaite pour la collecte de données, ce qui est exactement ce que la CAI attend des employeurs pour minimiser l’impact sur la vie privée.
Cette intégration est également un gage de robustesse face aux menaces. Cependant, le niveau de maturité des entreprises québécoises en matière de sécurité intégrée reste faible. Par exemple, seulement 20% des entreprises québécoises cryptent leurs communications, contre 48% en Ontario. Ce chiffre révèle un retard dans l’adoption de pratiques de sécurité fondamentales qui sont pourtant la base d’un système intégré fiable.
Le futur du contrôle d’accès n’est donc plus seulement une porte qui s’ouvre avec un badge. C’est un point de données intelligent au sein d’un écosystème de sécurité. C’est la capacité de votre système à répondre à la question « Que s’est-il passé ? » en corrélant l’heure d’un événement d’alarme, l’identité d’un badge et la preuve visuelle d’une caméra. Cette capacité de contextualisation est inestimable, tant pour une enquête interne que pour un dossier de preuve.
Investir dans une plateforme capable de faire dialoguer ces différents systèmes n’est plus un luxe. C’est une démarche stratégique qui augmente votre niveau de sécurité tout en renforçant la légitimité de votre collecte de données face aux exigences réglementaires.
À retenir
- La justification avant l’action : La légalité d’une caméra au Québec ne dépend pas de sa technologie, mais de votre capacité à prouver que son usage est proportionné à un risque réel et documenté.
- Minimisation par défaut : Chaque décision (emplacement, angle, technologie, durée de conservation) doit viser à collecter le moins de renseignements personnels possible pour atteindre votre objectif de sécurité.
- L’IA et la biométrie sont des zones à haut risque : Ces technologies augmentent vos obligations légales de manière exponentielle. Leur usage doit être exceptionnel et rigoureusement justifié, avec une ÉFVP à l’appui.
Votre système d’alarme est-il un gadget bruyant ou un véritable dispositif de sécurité ?
Dans un monde où les menaces sont de plus en plus sophistiquées, un système d’alarme qui se contente de faire du bruit n’est plus suffisant. Un véritable dispositif de sécurité en 2024 est un système intelligent, intégré et résilient, capable de faire face à la fois aux menaces physiques et numériques. La question n’est plus seulement « mon alarme va-t-elle se déclencher ? », mais « que se passera-t-il ensuite ? ». Sans une procédure d’intervention claire et une levée de doute efficace, une sirène n’est qu’une nuisance sonore qui peut même vous coûter cher en amendes municipales pour fausses alarmes.
L’intégration de la levée de doute vidéo est ici essentielle. Lorsqu’une alarme se déclenche, votre centre de télésurveillance doit pouvoir accéder brièvement à la caméra concernée pour confirmer visuellement s’il s’agit d’une réelle intrusion ou d’une fausse alerte. Cette confirmation permet une intervention policière plus rapide et prioritaire, tout en étant, encore une fois, un excellent exemple de collecte de données justifiée par un événement précis.
De plus, la résilience de votre système est primordiale. Dépendre d’une seule ligne de communication (internet ou téléphone) est une vulnérabilité majeure. Un système professionnel doit disposer d’une redondance des communications (IP, cellulaire, ligne terrestre) pour garantir que l’alerte soit transmise même en cas de coupure. La cybersécurité est l’autre face de cette médaille. Un système d’alarme connecté est une porte d’entrée potentielle sur votre réseau. La menace n’est plus seulement le cambrioleur, mais aussi le hacker. Les chiffres parlent d’eux-mêmes : selon un rapport récent, la moyenne des rançons payées au Canada s’établit à 160 652 CAD pour les cyberattaques, une somme exorbitante qui souligne la nécessité d’avoir un plan de réponse robuste.
Enfin, un système professionnel est un système certifié. Les certifications comme ULC (Underwriters Laboratories of Canada) ne sont pas de simples logos ; ce sont des garanties de qualité et de fiabilité exigées par de nombreux assureurs pour l’octroi de rabais sur vos primes. Elles attestent que votre installation respecte des standards élevés en matière de performance et de résilience.
Pour mettre en pratique ces conseils, l’étape suivante consiste à réaliser un audit complet de votre système actuel. Évaluez sa capacité d’intégration, sa résilience et sa conformité aux exigences de la Loi 25 avec l’aide d’un expert pour concevoir une solution qui protège réellement votre entreprise sur tous les fronts.